|
La "vase" dans le Loiret
Organisé
en une suite de bassins depuis plusieurs centaines d'années à partir
des marécages du val de Loire de l'Orléanais, le Loiret est un cours
d'eau qui "ne court pas".
La pente du bassin amont, qui
va des sources du parc floral au moulin de Saint Samson, est quasiment
nulle : la semelle béton du pont Bouchet est seulement plus haute de
5cm que le fond des vannes du moulin de Saint Samson.
Pire, le fond de la rivière au pont Bouchet est plus bas que les vannes de crue de Saint Samson, 3km à l'aval.

De plus, le débit restant globalement faible, la vitesse d'écoulement est négligeable : moins de 0,1 km/h dans les zones larges.
Dans ces conditions, il est facile de comprendre que les sédiments s'évacuent difficilement.
Les sédiments
On retrouve dans le Loiret des sédiments d'origine organique, fabriqués
par les êtres vivants, dont les feuilles des arbres consistuent la
majeure partie, et aussi, et surtourt, des sédiments d'origine minérale
tels que les sables et argiles.
D'où viennent ces sédiments ?
Le problème n'est pas nouveau, mais s'est accentué avec l'urbanisation
et l'imperméabilisation des sols, ainsi qu'avec la progression de la
culture intensive et les drainages des surfaces agricoles.
En 2007, une étude explique que 50% proviennent des exutoires pluviaux
et 50% du Dhuy, ce ruisseau transformé en chenal d'évacuation des
drainages agricoles au 20ème siècle, mais qui apporte aussi les sables
érodés aux coteaux de Sologne.
Cette étude estimait à près de 10 tonnes/Jour les sédiments en provenance du Dhuy ! Mais ce chiffre, déjà impressionnant, a été calculé au cours d'une année faible en précipitation et reste sous-estimé.
En 1926, le syndicat de rivière avait imaginé détourner le Dhuy pour le
faire passer sur une fosse naturelle dans laquelle il aurait déposé ses
sédiments.
En 1945, une étude minutieuse et exhaustive, conduite par des
ingénieurs d'état, déboucha sur une double opération : construction
d'un bassin de décantation pour piéger les sédiments les plus denses,
"Gobson", et extraction des vases obstruant le Loiret à la confluence
Dhuy-Loiret jusqu'en aval du pont Cotelle.
En 1991, une étude du SRAE, Service Régional de l'Aménagement des Eaux, estimait les apports du Dhuy à 3000 m3/an !
Il est raisonnable de penser que 30 à 50% des sédiments est transporté vers l'aval (les matières les plus fines).
50% de 3000, il reste 1500 m3/an. Toujours selon le SRAE, Gobson était capable d'absorber un peu moins de 1000 m3/an.
Mais l'entretien de Gobson a été négligé, et son seuil a été détruit en
2017 sur l'autel de la continuité écologique sans aucune étude
préalable, sans le vider, un gâchis...
Où en est le stock ?
Une évaluation avait été réalisée en 2006, une autre en 2016 estime le volume total à 300.000m3.
A
raison d'un dépôt de 1500m3/an, le stock de 300.000m3 aurait
théoriquement été déposé en 200ans. C'est un raisonnement simpliste mais qui permet d'apprécier les ordres de grandeur.
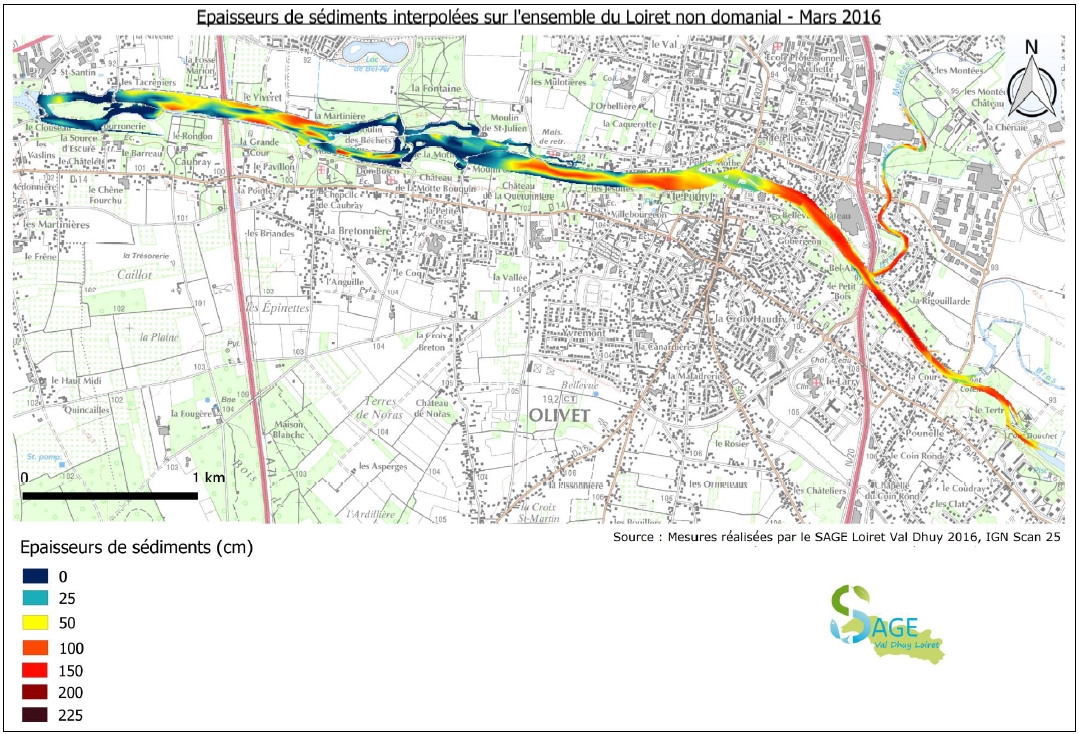
Il a été noté une baisse significative entre 2006 et 2016.
Les assises du Loiret écrivent : "Ces diminutions ont probablement été favorisées par les nouvelles vannes...".
Il faut préciser que ces nouvelles vannes (vannes de crue) ne sont
opérationnelles que depuis 2013 et que les vannes de décharge des
moulins sont ouvertes depuis 2007. Il apparaît plus rationnel d'imputer cette réduction à l'ouverture des vannes de décharge depuis 2007.
La bonne nouvelle, c'est qu'on peut raisonnablement penser que le phénomène de réduction du stock va continuer.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut penser avoir emporté la partie la plus facile, les
sédiments les plus fins. Il reste aussi les dépôts importants en aval de
la confluence Dhuy-Loiret consécutifs à la crue de 2016, ainsi qu'aux
destructions des barrages sur le Dhuy et celle du bassin de décantation
de Gobson.
Les moulins
Les moulins sont accusés de créer des obstacles à la continuité écologique et de favoriser l'envasement.
Ainsi, les assises
du Loiret écrivent : "Sur un cours d'eau artificialisé comme le Loiret,
la fonction de transport des sédiments s'effectue moins bien : les
écoulements étant presque nuls dans les zonnes de retenue des moulins,
les sédiments, et même les vases (sédiments les plus fins et légers) ne
peuvent plus être transportés et se déposent au fond du cours d'eau".
Non ! Il suffit d'observer le
flux au moulin de Saint Samson pour se rendre compte que le
rétrécissement des vannes de décharge augmente la vitesse d'écoulement
du flux, créant ainsi un phénomène d'aspiration qui facilite le
transport des sédiments.
Ce phénomène d'aspiration à l'amont des moulins est d'ailleurs confirmé par l'étude des vases de 2016.
Ce ne sont pas non
plus les moulins qui entraînent la prolifération des algues aquatiques,
comme l'écrivent encore les assises du Loiret.
Il convient plutôt d'en rechercher la cause dans l'abaissement des
niveaux d'eau qui favorise le réchauffement, ainsi que dans les apports
de nutriments.
Les assises écrivent encore : "Les
ouvrages hydrauliques sont autant d'obstacles qui empêchent certains
poissons d'atteindre une ou plusieurs zones essentielles à leur cycle
de vie".
Ce concept général ne s'applique
pas au Loiret où les vannes de décharge des moulins assurent la continuité
piscicole. Il faut rappeler que la destruction des barrages sur le Dhuy l'a transformé en chemin creux et sec l'été dernier ! |

|
La sédimentation
Dans le Loiret, le dépôt de sédiments est particulièrement important à
la confluence Dhuy-Loiret, le Loiret jouant le rôle de bassin de
décantation du Dhuy.
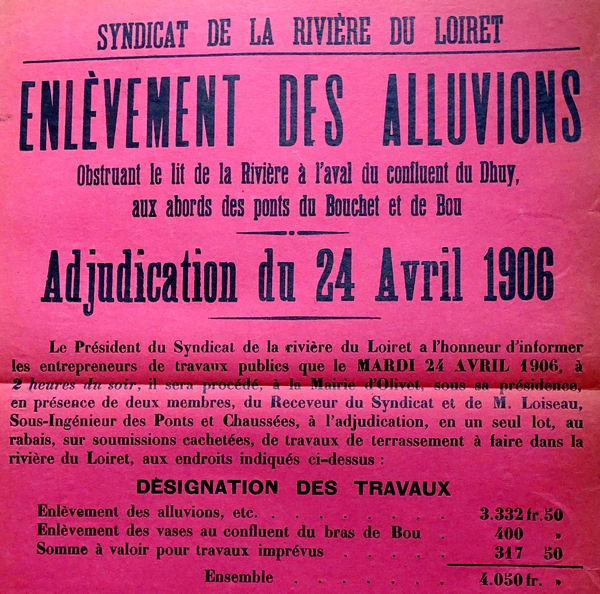 |
On trouve d'abord le sable grossier, puis immédiatement à l'aval le sable fin, puis les matières de plus en plus fines.
C'est
un phénomène bien antérieur à toutes les erreurs du 20éme siècle :
stations d'épuration, recalibrage du Dhuy, drainage intensif , engrais,
pesticides, bétonnage, etc.
1882, 1906,1926, 1930, 1945 marquent des dates d'extraction de
sédiments relevées aux archives.
Il est à penser que ces opérations
existaient déjà au cours des siècles précédents.
Le banc de
sable entre la confluence Dhuy/Loiret et le
pont
Bouchet se reforme ainsi cycliquement, parce que l’écoulement très lent du Loiret ne peut pas transporter
les
sédiments apportés par le Dhuy.
Ce sable grossier n’ira jamais plus loin (même la crue
exceptionnelle
de 2016 n’a pu le remobiliser et l'a plutôt consolidé).
|
Des solutions ?
Il
y a quelques années, la présidente de la CLE, la Commission Locale de
l'Eau, nous a expliqué qu'une extraction mécanique pouvait être
envisagée dans le cadre d'un projet.
Elle a lancé les assises du Loiret, et nous attendons toujours... car manifestement cette opération n'a pas son approbation.
La
CLE et la DDT sont arc-boutées sur leur volonté d'abaisser le niveau du
Loiret en ouvrant les vannes de crue pour emporter les sédiments, sans se préoccuper des
conséquences sur le système hydrogéologique, les constructions, la
biodiversité, le contexte sociologique.
Le faible gain en vitesse d'écoulement ne justifie pas le déséquilibre de l'écosystème.
De plus, le risque est d'entraîner les matériaux dans des zones plus larges et
moins accessibles.
L'extraction
mécanique (pelleteuse) du banc de sable de la confluence apparaît
inévitable. C'est un sable grossier qui peut être recyclé par les
entreprises de BTP.
Les
dépôts de vase sableuse à l'aval du pont Bouchet pourraient sans doute
être en grande partie retalutés en accord avec les riverains.
Plus en aval, le curage sera nécessaire...
Les vannes de décharge des moulins feront le reste.
Et Gobson ? Sauf à le reconstruire, il faudra accepter d'extraire le sable régulièrement à la confluence..
-
Enlever la vase, c’est transmettre aux
générations suivantes un patrimoine respecté dont nous ne sommes que
les
gardiens temporaires.
-
C’est aussi anticiper les dérèglements climatiques en préservant
l’intégralité
des masses d’eau pour mieux affronter les fortes sécheresses, mais aussi pour absorber les épisodes de pluie intense et
éviter
les inondations.
|
Curage : les techniques ont
évolué
Le curage était auparavant réalisé par un dragage mécanique qui créait beaucoup de désordre dans les cours d'eau.
Aujourd’hui,
le curage est souvent réalisé par succion
et la vase envoyée dans des poches à plusieurs centaines de mètres pour
décantage.La vase s'agglomère dans les poches qui laissent repartir l'eau par l'enveloppe microporeuse.
Une
fois débarrassé de la plus grande partie de
l’eau, c’est un produit qui peut servir à amender des terres agricoles,
ou plus
simplement être utilisé en matériau de remblai.
|
  |
La rivière Eure a été curée en février 2020. Le financement de 6 millons d'euros a été assuré à 100% par l'agence de l'eau.
https://actu.fr/normandie/criquebeuf-sur-seine_27188/video-curage-leure-attirer-poissons_30393782.html?fbclid=IwAR2rfx9m3fGF1FbHLMwm2aU7_iCXWVFcpSpdsk8ABVaOYbqU5KcgWe2_UNI
|

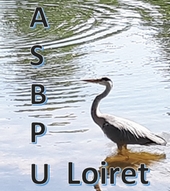 500
rue Francis Perrin
500
rue Francis Perrin